 Association des Familles Cliche (AFC)
Association des Familles Cliche (AFC) Association des Familles Cliche (AFC) Association des Familles Cliche (AFC) |
| Cette biographie de l'ancêtre Nicolas Cliche et de son épouse Marie-Madeleine Pelletier est un résumé des chapitres 2, 3 et 4 du tome 1 de Histoire et généalogie des familles Cliche, de l'auteur Marcel Cliche, publié à l'automne 2006. Ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire de la famille Cliche et aux familles alliées peuvent se procurer cet ouvrage en se référant à la page Publications et articles-souvenir. (cliquez ici) |
|
La naissance de Nicolas Nicolas Cliche, l’ancêtre de tous les Cliche d’Amérique, est né le 8 juillet 1645, dans la paroisse Saint-Jean de Saint-Quentin, évêché de Noyon, en Picardie, France. Il est le fils unique d’un premier mariage de Nicolas Cliche et de Catherine Poette. Lorsque son père contractera un second mariage avec Marguerite Bauny, le couple aura trois enfants : Paul, né en avril 1652, André, né vers 1662, et Jeanne, qui a épousé Pierre Lobert, le 7 février 1684, à l’église de la paroisse Saint-Jean.
Au temps des Nicolas, père et fils, (env. 1620–1671), les
Cliche de Saint-Quentin semblent former deux clans qui gravitent autour
de quatre paroisses, Saint-Thomas, Sainte-Marguerite,
Saint-André et surtout Saint-Jean, toutes à
proximité de la Collégiale. Cependant il semble qu'il faille rechercher vers l'est les origines du
paternel de Nicolas et son ascendance plus lointaine,
grand-père, arrière-grand-père, etc. De l'est vers
l'ouest, entre Vervins et Saint-Quentin, distancé de 50 km, des
Cliche ont été signalés dans douze communes de la
Thiérache dans la première moitié du 17e
siècle dont Chigny, Marly-Gomont, Autreppes, St-Algis,
Wiège-Faty, Fontaine-lès-Vervins, Haution et Le
Hérie-la-Viéville. À celles-ci s'ajoute le village
de Bernot plus à l'ouest.
ACTE DE BAPTÊME DE NICOLAS CLICHE
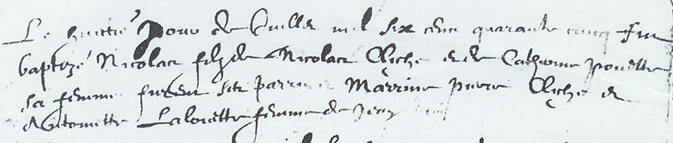 baptisé Nicolas fils de Nicolas Cliche et de Catherine Poette sa femme furent ses parrain et marraine Pierre Cliche et Antoinette Lalouette femme de Jean Leroy. |
|
La jeunesse et l'adolescence
La
pénombre enveloppe ses vingt-six années comme citoyen de
Saint-Quentin, mais l'histoire de la ville permet d'imaginer le
passé de Nicolas. Un document unique, le plan de Saint-Quentin
en 1557, lithographié au XIXe siècle par Édouard
Cliche, reproduit dans ses grandes lignes la ville telle qu'elle
était au temps des Nicolas, père et fils. L'aspect et le
développement du bourg sont restés les mêmes du
XIIIe siècle jusqu'au lendemain de la Révolution
(1789). La ville comptait déjà à l'époque
médiévale de sept à huit mille habitants.
Six portes donnaient accès au bourg. Les Cliche vivaient au nord-est de la cité, dans la paroisse Saint-Jean, à l'intérieur des remparts. Le faubourg du même nom, «essentiellement agricole» était hors les murs et la communication entre les deux s'effectuait par la Belle-Porte qui menait à un donjon flanqué de quatre tourelles. Elle devint la porte Saint-Jean à cause de sa proximité avec l'église Saint-Jean, où Nicolas est monté sur les fonts baptismaux, et de la voie qui la traverse, la rue Saint-Jean (aujourd'hui Raspail). Le chemin qui la prolonge conduit à Cambrai et par une bretelle à sa droite, au Cateau-Cambrésis, deux foyers de porteurs du patronyme Cliche à partir des 18e et 19e siècles. En juillet 1645, le mois même de la naissance de Nicolas, trois cents Saint-Quentinois dirigés par leur gouverneur repoussent les ennemis (Espagnols) qui ravagent le comté. L'année suivante une émeute éclate. Le sang coule. Les bourgeois s'opposent à un impôt, nommé la taxe des aisés. Nicolas, enfant et adolescent, n'a pu manquer les visites du roi Louis XIV, le Roi Soleil, en 1654, 1657, 1670 et 1671, la misère «effroyable» des années 1650 à 1656 provoquée par les passages des armées et les dévastations des campagnes jusqu'aux fossés de la ville, les manifestations de joie à l'occasion de la signature du traité des Pyrénées avec les Espagnols, en 1659, qui amène une paix durable et la reprise de l'essor économique au même niveau qu'avant le siège de la ville en 1557. Il voit aussi la reconstruction des fortifications de la ville selon les plans du célèbre architecte militaire, Vauban. Dans sa jeunesse, il a peut-être participé à la course annuelle du mardi gras qui se tenait dans les Coutures, les terres agricoles au-delà de la porte Saint-Jean, donc tout près du foyer de ses parents. Il a sans doute été témoin de l'incendie du 14 octobre 1669 qui détruisit les deux clochers, les orgues et la toiture de la nef de la collégiale. Si Nicolas retournait dans sa ville aujourd'hui, il se reconnaîtrait par la géographie des lieux, des détails topographiques, la disposition des places, des rues et des monuments. Même si elle a été détruite à près de 80% lors de la grande guerre (1914–1918) et que ses remparts ont été enlevés en 1801, la configuration du Vieux Saint-Quentin est restée sensiblement pareille.
|
| Le départ pour l’Amérique
Nicolas vient d'atteindre 25 ans,
lorsqu'il décide de partir pour le Nouveau Monde. Il a
sûrement l'expérience du travail. Fut-il arquebusier,
ouvrier de fabrique, laboureur ou manouvrier (journalier) dans la
cité ou dans les champs de lin qui l'entourent? Le contrat
d'engagement pour l'Amérique, s'il y en a un, pourrait
éclairer notre lanterne.
À l'hiver 1671, Nicolas s'affaire aux préparatifs pour le départ. Il doit prévoir le temps nécessaire sans oublier les imprévus pour se rendre au port d'embarquement, probablement le port de Dieppe, le plus rapproché de Saint-Quentin et un port d'embarquement important pour les vaisseaux à destination de la Nouvelle-France, au XVIIe siècle. Le site de l'Association des familles Bérubé inc. identifie ce bateau. Il s'agit du «Saint-Jean-Baptiste», un vaisseau de 300 tonneaux qui, selon les archives de Dieppe, transportait quatre ouvriers, ainsi qu'une centaine d'hommes et vingt-six «Filles du roi». Il lève l'ancre à la fin juin et il est presque certain qu'il a embarqué l'ancêtre des Cliche. Ce voilier dirigé par le capitaine Pierre Lemoyne n'en est pas à son premier voyage en Amérique; il est signalé en 1664.
La traversée de l’Atlantique au 17e siècle
présente de multiples dangers et bien peu de plaisir. La
durée est imprévisible, de 20 à 100 jours. Les
tempêtes, les naufrages, la maladie et la mort guettent les
prisonniers de ces boîtes d’allumettes ballottées
par des vagues sournoises. Vers la mi-août 1671, le Saint-Jean-Baptiste arrive en face de
Québec et jette l’ancre dans le port du Cul-de-Sac
à quelque distance du rivage.
|
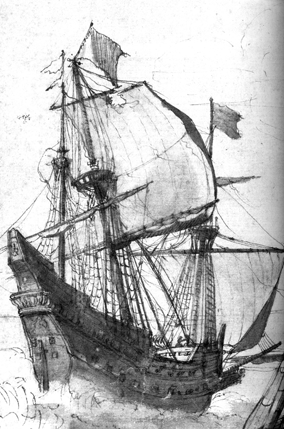 |

|
Québec 1671-1675
Lorsque Nicolas met pied à terre à Québec en 1671,
ça ne fait que 37 ans que la colonisation du Canada est
réellement commencée. Même si Québec a
été fondée par Champlain en 1608, la prise de
Québec par les Anglais en 1629 remet tout en question. Il faut
repartir pratiquement à zéro, après leur
départ, le 13 juillet 1632. L’arrivée de Robert
Giffard, en mai 1634, avec plusieurs colons recrutés au Perche
(Cloutier, Guyon (Dion), Langlois, Boucher, Giroux, etc.) marque les
véritables débuts du peuplement de la colonie.
Nicolas doit s’adapter à la ville et au pays. A-t-il un contrat d’engagement ou est-il recruté sur place? Aucun document ne tranche ces questions, mais nous savons qu’il a été engagé à titre de domestique par Nicolas Gauvreau, maître arquebusier, armurier et même serrurier. Les conditions d’engagement doivent ressembler à celles du domestique précédent, Henri Piot, c’est-à-dire logement, nourriture et quarante-six livres de gages. Il doit servir son maître «et faire tout ce que peut et doit faire un bon et fidèle domestique selon ses forces sans pouvoir s’absenter pendant tout le temps de son engagement». La durée de l’emploi semble plus flexible que pour les apprentis et les gens de métier qui sont sous le régime des 36 mois. Est-ce la servitude qui ne lui convient pas, la rigueur du climat, la vie à Québec, la nostalgie du pays d’origine, l’ennui ou l’attirance de la vie libre des coureurs des bois qui l’ont poussé à commettre un geste illégal? Après huit mois de service, Nicolas prend la poudre d’escampette. Laissons la personne lésée décrire le crime commis dans la requête à Monseigneur l’intendant, le 20 mai 1672: «suppliant humblement Nicolas Gauvreau, maître armurier de cette ville disant qu’il y a quinze jours que les nommés Claude Couturier et Nicolas Clisse, des domestiques se seraient (évadés ?) de son service et accompagnés de trois hommes se seraient embarqués dans un canot pour aller à l’Isle de Percé après avoir pris cinq fusils dans la boutique…». Les relations du patron avec ses nombreux employés, domestiques et apprentis, sur plusieurs années, semblent irréprochables. D’ailleurs, il affirme dans la requête «qu’il n’a jamais donné aucun subjet aux dits Couturier et Clisse de le quitter et de déserter de cette manière». Sachant que ses serviteurs ont été faits prisonniers à Percé et ramenés à Québec, il demande à l’intendant de rendre justice, en les obligeant à payer les journées perdues et à remettre les fusils pour qu’ils soient «rendus aux particuliers à qui ils appartiennent». Le document qui rapporte la fuite de Nicolas est très important pour l’histoire des Cliche parce qu’il constitue la première mention de la présence de l’ancêtre dans le Nouveau Monde. Il confirme aussi, hors de tout doute, son arrivée en 1671. Il s’agit bien de notre Nicolas, même si l’orthographe est Nicolas Clisse que l’on reverra dans d’autres documents.
Malgré la faute commise par Nicolas, un maître acceptera
de lui montrer un métier. Selon la coutume et les règles
du temps, il est fort possible qu’il soit retourné chez
les Gauvreau pour payer sa dette. Une chose est certaine, il
s’est amendé et raccommodé avec ceux-ci.
L’artisan se retrouve dans le petit groupe des parents et amis
rassemblés, lors de la rédaction du contrat de mariage,
le 2 septembre 1675. Il laisse sa signature au bas du parchemin. Son
épouse, en plus d’être la sage-femme, sera la
marraine du premier bébé des Cliche.
Nicolas apprenti serrurier doit gagner la confiance de son maître et respecter les règles d’apprentissage du métier. Contrairement à la France où la maîtrise s’obtient par la production d’un chef-d’œuvre après les stages d’apprentissage et de compagnonnage (apprenti–compagnon–maître), en Nouvelle-France, l’intendant Jean Talon a supprimé des étapes. Il accorde la maîtrise à «toute personne ayant pratiqué un métier pendant six ans sans interruption» ou après trois ans ou plus d’apprentissage auprès d’un artisan. Les quatre premières années de Nicolas à Québec s’écoulent surtout dans les rues Sous-le-Fort et de la Fontaine de Champlain, où se concentrent les gens de métier qui y tiennent boutique, y compris Nicolas Gauvreau et Jean Amiot, ses maîtres et amis.
|
|
Nicolas se marie
Nicolas est Français, mais les quatre années à
respirer l’air du Nouveau Monde l’ont changé. Il
s’est imprégné du milieu et il s’est
adapté au pays et à la ville. Il a pris du galon par la
maîtrise d’un métier noble et en gagnant
l’amitié et la confiance de nombreuses personnes. Parmi
celles-ci, le couple Jean Amiot et Marguerite Poulin qui lui
présentera Marie-Madeleine Pelletier et répondra de lui
devant les parents de cette dernière, Georges Pelletier et
Catherine Vannier, qui habitent Saint-Anne-du-Petit-Cap.
Maître ou pas de Nicolas dans l'apprentissage de son métier de serrurier, Jean Amiot, avec l'aide de son épouse Marguerite Poulin, joue un rôle important dans la romance de Nicolas et de Marie Madeleine. Leur signature au bas du contrat de mariage de Nicolas révèle leurs liens d’amitié. Par ailleurs, Georges Pelletier et son épouse étaient des amis de Claude Poulin et assistaient au mariage de la fille de ce dernier avec Jean Amiot en août 1673. De plus, Marie-Madeleine Pelletier et Marguerite Poulin étaient du même âge et se tenaient souvent ensemble. Elles se retrouvent en même temps au pensionnat des Ursulines à Québec. Marie Madeleine y passe trois mois, du 20 mai 1669 à la fin d’octobre, tandis que Marguerite y étudie 6 mois, du 9 juin 1669 à février 1670. Le couple Pelletier-Vannier donne son consentement et, le 2 septembre 1675 à Québec dans la maison de Jean Amiot, les parents, les amis et les témoins rassemblés se présentent devant le notaire Pierre Duquet pour la rédaction du contrat de mariage. Marie-Madeleine est née le 6 août 1658; elle a donc 17 ans lors de son mariage, tandis que Nicolas est âgé de 30 ans. Ce mariage aura lieu le dimanche 13 octobre 1675, en l’église de Sainte-Anne-de-Beaupré. L’union a été bénie par le prêtre missionnaire François Fillon. À l’exception des époux et de leurs parents, cinq personnes sont mentionnées sur l’acte de mariage : Guillaume Morel, fraîchement arrivé et futur beau-frère des mariés, Robert Foubert, voisin des Pelletier, du côté est, et François Ringault, témoin mystérieux connu seulement par ce document, et le prêtre F. Fillon.
|
|
Les belles années (1675 - 1681)
Nicolas
et Marie-Madeleine, heureux et pleins d’espoir dans la chaloupe
qui les ramène de Sainte-Anne à Québec, ont
hâte de se retrouver dans l’intimité de leur foyer.
Ils avaient tout prévu car le 8 septembre 1675, un mois avant le
mariage, Nicolas avait loué d’un bourgeois de la
Basse-Ville, Noël Pinguet, la moitié d’une maison
pour un bail de deux ans «avec la cave au-dessous et le grenier
au-dessus, aprendre joignant Robert Paré jusqu’à la
clouaison qui sépare ladite maison présentement en
l’estat ou elle est, Et aussi du haut en bas». |
|
Les temps difficiles (1682-1687)
|
|
La famille
Nicolas Cliche et Marie-Madeleine Pelletier ne seront que douze ans en
ménage, du 13 octobre 1675 au 23 décembre 1687. La
durée de leur union est dans la moyenne de
l’époque, soit de dix à vingt ans, au maximum.
Dans ce laps de temps, Marie-Madeleine met au monde sept enfants, dont six vivront plus de dix ans. Les trois premiers, Nicolas (1676), Jean-François (1678) et René (1680), voient le jour sur la rue Notre-Dame et les quatre autres, la fille unique qui porte le prénom de sa mère, Marie-Madeleine (1681), Claude (1683), Vincent (1685) et Nicolas-Lucien (1687), dans leur propriété de la Côte-de-la-Montagne. Ils ont tous été baptisés dans la paroisse Notre-Dame et dans l’église du même nom, basilique-cathédrale de Québec, sur la rue Buade. Le recenseur qui visite les Cliche vers mars 1681, les enregistre sous le patronyme Queliche. Le nom semble difficile à saisir parce qu’il est souvent orthographié Clisse et parfois Claiche, par les greffiers et les notaires. Les âges des quatre enfants sont corrects, par contre, Nicolas s’est rajeuni de huit ans (28 ans au lieu de 36 ans) et Marie-Madeleine de plus de 2 ans (20 ans au lieu de 22 ans et 4 mois). Au recensement de 1681, l’administration dénombre les armes à feu, les bêtes à cornes et le nombre d’arpents de terre en valeur. Nicolas Cliche déclare un fusil; Nicolas Rousselot, le voisin, un fusil, deux pistolets et 6 arpents en valeur. Nicolas et Marie-Madeleine auraient de bonnes raisons de se réjouir et de célébrer leur dixième anniversaire de mariage, en octobre 1685, car les six enfants nés jusqu’à ce jour sont tous vivants et tourbillonnent dans le foyer. Les âges varient de 1 an à 9 ans. Cependant la grande faucheuse rôdait sur la colline. Elle élimine en un an tous les Nicolas de la famille. Elle vient d’abord chercher, l’aîné des enfants, Nicolas, le 7 novembre 1686. Il avait fêté ses dix ans, un mois auparavant. Huit mois plus tard, le 24 juillet 1687, elle ne laisse que 17 jours d’existence au poupon, Nicolas-Lucien. Insatiable, elle frappe Nicolas, la souche, le pionnier et l’ancêtre des Cliche d’Amérique, le 23 décembre 1687. Il avait 42 ans. La cérémonie des funérailles s’est déroulée dans la cathédrale de la paroisse Notre-Dame de Québec. Il est probable qu’il a été parmi les derniers à être inhumé dans le premier cimetière de Québec, «le terrain triangulaire qu’on voit, à droite de la côte de la Montagne». «Il fut le champ des morts de Québec jusqu’en 1688». Désormais Marie-Madeleine Pelletier, mère et tutrice, doit réorganiser la vie familiale pour subvenir aux besoins de cinq enfants en bas âge : Jean-François (9 ans), René (8 ans), Marie-Madeleine (6 ans), Claude (4 ans) et Vincent (2 ans). Les trois derniers prendront racines pour assurer la postérité du couple Cliche-Pelletier et la prospérité du patronyme Cliche. Nicolas Cliche n’aurait sans doute jamais pensé que son nom passerait à l’histoire et que trois siècles et demi plus tard des milliers de descendants honoreraient sa mémoire. Son exploit vient justement des 20 000, 30 000, 40 000 Nord-Américains qui le retrouvent dans leur arbre généalogique. Il ne pourra jamais être oublié!
ACTE D'INHUMATION DE NICOLAS CLICHE
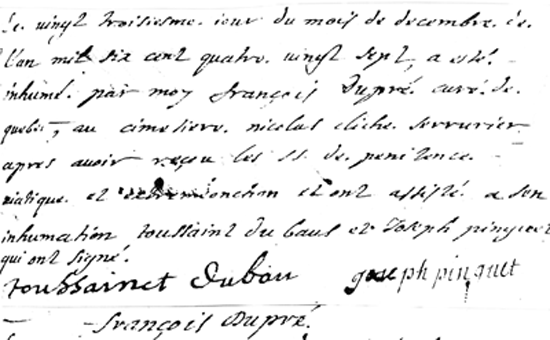 Le vingt troisième jour de décembre, de l’an mil six cent quatre vingt sept, a été inhumé par moy François Dupré, curé de Québec, au cimetière, Nicolas Cliche, serrurier, après avoir reçu les ss.[saints sacrements] de pénitence, viatique et extrême onction et ont assisté à son inhumation toussaint du baus et Joseph Pinguet qui ont signé. toussaint dubau joseph pinguet françois Dupré |
|
Marie-Madeleine Pelletier : un nouveau foyer 1– CHEF DE FAMILLE
– Les locations Qu’est-ce qui attend la famille après le trépas du chef de la communauté ? Marie-Madeleine hérite d’une maison hypothéquée et d’une situation financière précaire, avec cinq enfants sur les bras. Elle prend rapidement des mesures pour s’assurer des entrées d’argent. Curieusement, les biens immobiliers qui ont perturbé leur vie serviront de monnaie d’échange, autant durant la période de veuvage que celle du remariage. Trois semaines après la disparition de Nicolas, le 17 janvier 1688, elle loue l’emplacement, la maison et la boutique attenante, situés «sur la rue montant de la basse à la haute ville», à Jeanne Badeau, pour son fils mineur, Joseph Parent, qui ne peut contracter à cause de sa minorité. Marie-Madeleine se réserve dix pieds dans la cave sur toute sa profondeur où elle fera une cloison, une chambre, et l’accès à la fontaine. Elles s’entendent pour le prix de 160 livres par année pour une durée de trois ans. Elle ne touche pas à cet argent. Il est réparti entre les créanciers : dix livres aux pères Jésuites, un autre dix livres à une personne non déchiffrée et le surplus au sieur Charles Auber de La Chesnaye, présent, et signataire du contrat qu’il approuve. Quatre jours plus tard, le 21 janvier, elle va chercher un montant de cinquante livres, en louant les outils de son époux. Elle transige dans tous les contrats en tant que mère et tutrice naturelle des enfants du défunt. La résidence des Cliche est bien située et probablement très convenable parce qu’elle trouve facilement preneur. Tous les baux sont de trois ans consécutifs, au tarif de 120 livres, à l’exception du premier dont la durée de location fut moindre que prévue et le coût plus élevé parce qu’il comprenait l’atelier. Le bail du 7 juin 1690 à Julien Boissy dit la Grillade, pâtissier, permet de se faire une bonne idée du logis. Il comprend une chambre à feu, qui sert peut-être de cuisine, trois petites chambres, une cave et un grenier, sans compter la cour, close par des pieux, le jardin, la fontaine et la boutique. Est-ce que la chambre basse, qu’elle se réserve, fait partie des appartements décrits ? On ne peut répondre. Les réparations dominent ce contrat. Elle tient à garder le bâtiment dans un bon état. Le locataire se charge des réparations et de l’ajout de commodités : «un four suivant la place propre pour iceluy dans la maison […], trois contrevents avec croisettes, une porte à la cave avec serrure et verrou, et une trape pour ladite cave». La cheminée servant de forge sera réparée par Joseph Parent, le locataire précédent. Les enfants ne font pas partie du décor pendant les trois ans de célibat de leur mère, à part les mentions qu’ils existent dans les contrats. Des indices permettent cependant de reconstituer des bribes de la vie familiale. Elle séjourne assez souvent à Sainte-Anne chez son père dans la soixantaine et chez sa sœur. Il est difficilement imaginable qu’une famille de six personnes vive dans la chambre qui lui sert de logement à Québec. Elle se dit de Sainte-Anne lorsque des problèmes de santé l’amènent à l’Hôtel-Dieu de Québec, en juin et juillet 1690, quelques mois avant le deuxième mariage. Même après avoir pris mari, elle semble faire la navette entre le lieu de pèlerinage et Québec. À sa troisième hospitalisation, le 28 février 1694, elle s’enregistre de Sainte-Anne. Elle se trouve au même endroit, le 2 et le 28 août 1695, pour jouer le rôle de marraine de Marie-Angélique Morel, fille du deuxième lit de Guillaume, et de Louise Racine, mais les actes indiquent Québec comme lieu de résidence. La calligraphie des signatures des quatre garçons et un texte destiné à l’un deux, Claude Cliche, démontrent non seulement qu’ils savent signer, mais que des fils de Nicolas maîtrisent l’écriture et la lecture. Ils ont donc fréquenté ou fait des séjours dans une école ou une institution. Peuvent-ils être allés au collège des Jésuites, qui donne un enseignement plus général que le Séminaire et le couvent des Récollets qui se consacrent à la formation de religieux ? Rien n’est certain ; mais comme les Jésuites ont aidé leurs parents et qu’un des fils de Claude Cliche, Claude comme son père, y étudiera, les probabilités sont plus fortes du côté des disciples de Saint Ignace de Loyola. Il y en a au moins deux qui apprendront des métiers. 2– «Une assurance sur la vie» Marie-Madeleine se cherche un compagnon car les conditions de vie de l’époque ne laissent pas le choix. «Sitôt que le mariage est rompu par la mort d’un des conjoints, on cherche à se remarier, car il est difficile à pourvoir à sa subsistance et à celle des enfants sans un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne […]. Le mariage est considéré comme une assurance sur la vie : quatre bras valent mieux que deux pour lutter contre les innombrables difficultés de la vie quotidienne». Le «marché des femmes à marier» et son âge, 29 ans en 1688, la favorisent; par contre les cinq enfants à sa charge constituent le handicap. Le temps d’attente sera dans la moyenne de l’époque, puisqu’un chevalier mord à l’hameçon dans sa troisième année de veuvage. En effet, le 9 novembre 1690, elle passe un contrat de mariage avec Pierre Millet (Millier et Milliet), un Français baptisé le 1er septembre 1653 à Notre-Dame-de-Mirebeau, évêché de Poitiers, au Poitou, fils de Vincent, chapelier, et de Claude Perrin. Il est signalé en Nouvelle-France en 1687. Il habitait chez Jean Charron dit Laferrière, un familier des Cliche, parrain de leur premier enfant, peut-être à l’origine de la rencontre Millet-Pelletier.
Elle déclare devant le tabellion que la maison de la côte
de la Montagne, hypothéquée aux créanciers du
défunt, est le seul bien qui lui reste de la communauté
créée par la première union. Le futur époux
se dégage de cette dette «sans quoi il n’aurait fait
ou contracté led. [ledit] mariage avec elle». Avec ces
quelques mots, la balance penche vers un mariage
d’intérêt ou de circonstance, même s’il
affirme qu’advenant son décès dans l’ancienne
France ou dans ce pays à quelque endroit qu’il puisse
être situé, il lui cède tout ce qui peut lui
appartenir pour «l’amour qu’il lui porte». Il
se montre aussi généreux sur le douaire préfix,
c’est-à-dire sur le montant négocié avant la
passation du contrat de mariage. Il l’assure de 600 louis sur ses
biens propres en cas de décès.
|

La fin de Marie-Madeleine Pelletier
Marie-Madeleine Pelletier, l’ancêtre maternelle des Cliche
et d’une partie de la descendance Millet, rend l’âme
le 2 ou 3 décembre 1701.
Huit enfants, cinq Cliche et trois Millet perdent une mère attentionnée qui leur a donné l’amour et l’éducation pour réussir leur vie. Elle a supporté ses deux maris, un dans ses absences et l’autre en l’aidant à passer à travers ses problèmes financiers et peut-être personnels. Quand il le fallait, elle a pris la relève dans plusieurs transactions qu’elle signe d’une écriture plus assurée que celle du contrat de mariage. À moins d’une mort accidentelle, ou des suites évidentes d’un accouchement ou d’une épidémie, il est difficile de connaître les causes de la mort à 300 ans de distance. Pour Marie-Madeleine, ce peut être l’usure du temps malgré ses 43 ans, la maladie, la grossesse et l’accouchement d’Élisabeth-Geneviève dont elle ne s’est pas relevée, ou des suites tardives de l’épidémie de grippe de l’hiver 1700-1701 qui est venue chercher des personnes très en vue, comme l’ecclésiastique Henri de Bernières qui a baptisé au moins cinq enfants de Nicolas Cliche, Gervais Beaudoin, le médecin de l’Hôtel-Dieu, le notable Louis Rouer de Villeray, premier conseiller au Conseil Souverain, etc. Moins de deux mois après le décès de Marie-Madeleine, une prétendante, Louise Pelletier, mord à l’hameçon de Pierre Millet. Le contrat se signe le 27 janvier 1702, mais le mariage n’aura pas lieu. Il ne lâche pas prise et il conquiert la veuve de Pierre Lefebvre, un matelot de Saint-Malo, en Bretagne, Marie Salois, qu’il épouse le lundi 20 novembre 1702 à Saint-Laurent, île d’Orléans. Quatre des huit enfants procréés par cette union se marieront.
|

NDLR: Né en 1645 dans le faubourg
Saint-Jean de la ville de Saint-Quentin, en Picardie, Nicolas, l’ancêtre des Cliche
d’Amérique, s’il parlait français, employait aussi, sans doute souvent,
le patois picard. En effet, Saint-Quentin est bien enracinée dans le
domaine linguistique picard (voir la carte ci-dessous ). La langue
picarde a connu son apogée au Moyen Âge, avant d’être peu à peu
remplacée par le français. À l’époque de l’ancêtre Nicolas (milieu du
17e siècle) le picard était devenu un patois. Mais le picard, comme
langue à part entière, a toujours eu ses défenseurs. Et, avec la
sortie sur les écrans en 2008 du film français Bienvenue chez les
Ch’tis, le picard a retrouvé en quelque sorte ses lettres de noblesse.
|
L’histoire de la langue picarde Le
picard et le français partagent des origines communes, au sein d’un
groupe de langues apparentées, généralement dénommées « langues d’oïl
», parlées dans la France du Nord : ces langues ont évolué à partir du
latin populaire amené par les légions romaines et adopté par les
habitants de la Gaule, puis, à partir du 5e siècle, sous l’influence
des parlers germaniques des envahisseurs francs.
Le chanteur belge Julos Beaucarne disait que « le wallon est du latin venu à pied du fond des âges ». On pourrait en dire autant du picard… et aussi du français ; simplement, chacune de ces langues a emprunté un chemin légèrement différent ! Peut-être - hypothèse purement gratuite - celui du picard débute-t-il dans la manière particulière dont « nos ancêtres les Belges » ( les Gaulois du Nord ) prononçaient le latin des occupants, sans doute aussi a-t-il subi une influence plus forte des parlers germaniques (au Nord de la Somme, les Francs sont arrivés plus tôt et en plus grand nombre que vers le Sud, là où on parle « français » et d’autres langues d’oïl ). Les échanges avec le flamand, tout proche, sont encore sensibles dans le vocabulaire et la syntaxe du picard, bien qu’il ne faille pas exagérer outre mesure leur influence. L’un des tout premiers textes en « langue vulgaire » du Nord de la France, la Séquence de Sainte Eulalie, écrit à la fin du 9e siècle dans la région de Saint-Amand, comporte déjà des traces de picard : on y trouve des mots comme coze « chose », diaule « diable », encore utilisés de nos jours dans les conversations en « patois ». L’histoire de la littérature picarde a donc commencé il y a onze siècles ! Elle fleurit ensuite entre les 12e et 14e siècles : au Moyen Âge, des écrivains prestigieux comme les Arrageois Adam de la Halle et Jean Bodel, ou, en Picardie, Jacques d’Amiens ou Robert de Clari, écrivent en picard. Plus exactement, ils utilisent une écriture hybride franco-picarde, mélange d’ « ancien français » et de dialectalismes régionaux. Il en est ainsi dans toutes les régions du Nord de la France mais l’écriture picarde jouit au Moyen Âge d’une popularité qui dépasse les limites de son domaine linguistique, ce qui permet à des linguistes comme Henriette Walter de parler d’une « exception picarde » : c’était la grande langue de littérature du Nord de la France, comme le provençal était celle du Sud. Dans le même temps, les textes juridiques de l’époque (en particulier les Chartes) font un usage abondant de cette écriture picarde. Néanmoins, le picard n’apparaît plus guère dans les textes après le 15e siècle, après s’être quasiment dilué dans le français standard ; il perd alors toute légitimité comme langue de littérature. Cela ne signifie pas pour autant qu’il disparaît de l’écrit : mais les œuvres qui sont composées en picard à partir du 17e siècle le sont dans un but de transgression, pour marquer la complicité avec le lecteur, et surtout pour faire rire. Il y a eu une rupture, on est entré dans une nouvelle période, celle de la littérature « patoisante », telle qu’elle perdure encore de nos jours. Du coup, ce qu’il perd en légitimité, le picard le gagne en authenticité et en « pureté » : désormais, on écrit en picard pour ne pas écrire en français (alors qu’au Moyen Âge on écrivait en picard en croyant écrire en français...), on « en rajoute », en quelque sorte, sur les différences avec la langue nationale, et c’est ainsi que se constitue véritablement le picard moderne comme langue littéraire. SOURCES: © A. Dawson, 2002
Origine du mot « ch’ti »
Le
mot « ch’ti » ou « ch’timi » a
été inventé durant la Première Guerre
mondiale par des soldats qui n’étaient pas de la
région et qui
désignaient ainsi leurs camarades originaires du Nord de la
France. Ce
mot a été créé à partir des mots
« ch’est ti, ch’est mi » ( « c’est
toi, c’est moi » ).
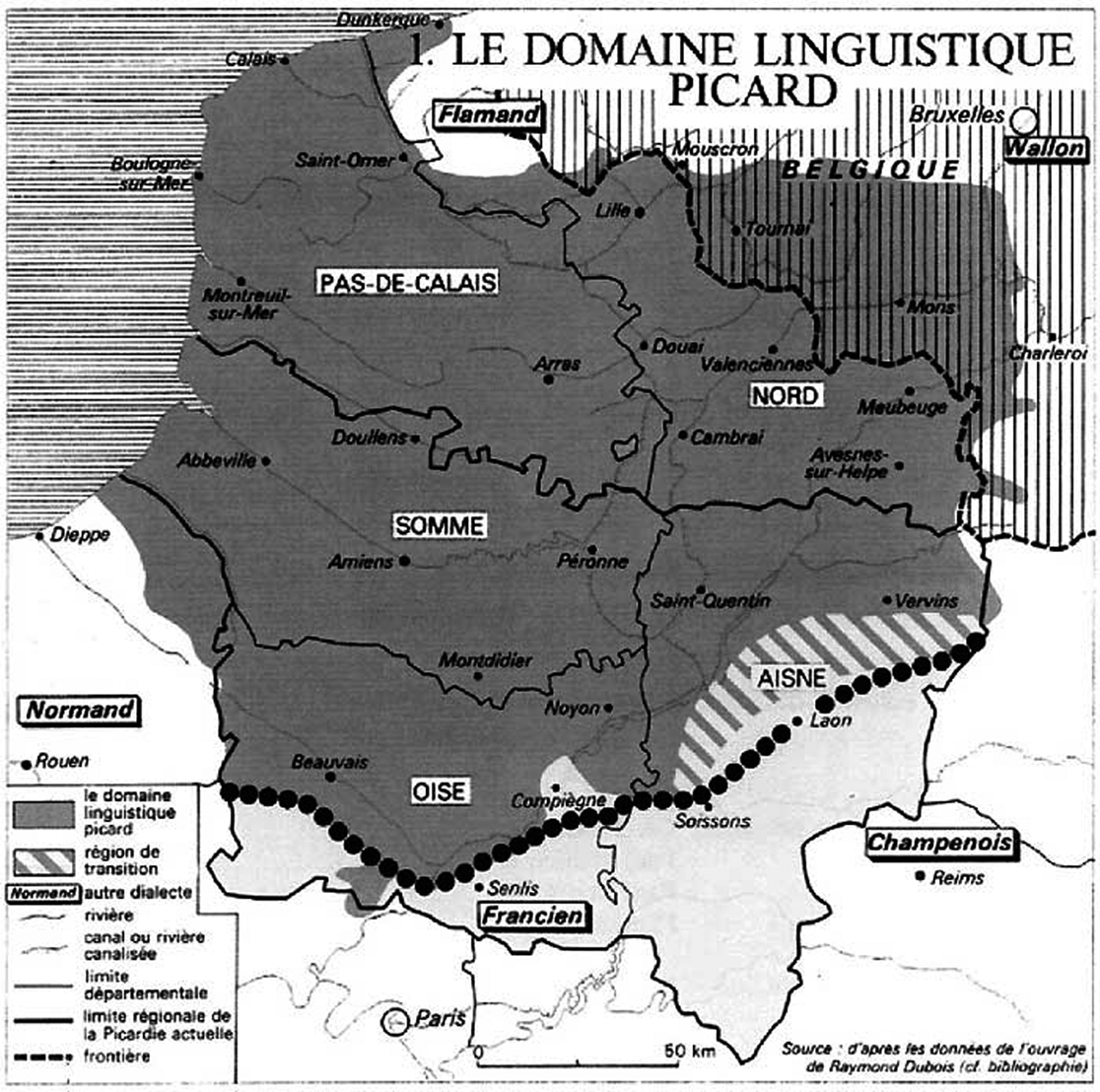 Le picard est une langue régionale (au sens de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires) parlée en France dans les régions Picardie et Nord - Pas de Calais, et en Belgique dans la province du Hainaut. Dans le Nord - Pas de Calais, il est souvent appelé improprement « patois de Nord » ou « Chtimi », et « Rouchi » dans la région de Valenciennes. En France, le picard est recensé dans le rapport Les langues de la France du professeur Bernard Cerquiglini, remis aux ministres de la Culture et de l’Éducation nationale en mai 1999. En Belgique, il constitue l’une des langues régionales endogènes visées par un décret de la Communauté Française de Belgique de 1990.
_________________________________________
|
